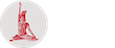A l’heure où tout le monde fait ses vœux - souvent pour souhaiter à l’autre ce que l’on voudrait se souhaiter à soi-même en fonction de nos préoccupations ou notre conscience du moment - nous mettons dans nos bonnes intentions envers autrui, des souhaits qui relèveraient d’un étrange pouvoir que nous aurions, une fois par an, à pouvoir les faire se réaliser.
Bien sûr, ces vœux n’étant que des souhaits, nous savons que nous avons la forte probabilité de ne pas avoir ce pouvoir. Après tout, le pouvoir de l’intention peut faire des miracles. voir conférence « L’intention du poussin ».
C’est ainsi que nous faisons des vœux de santé, sans pouvoir forcément la donner, des voeux de prospérité sans être nous-même la corne d’abondance, de légèreté alors que nous savons que les soucis sont le lot de chacun de nous. Le plus souvent, nous allons recevoir ou émettre alors le fameux credo semblant digne du bon sens : « la santé d’abord » !
C’est oublier que certains préfèrent la richesse avec une santé médiocre qu’être pauvres et en bonne santé. D’autres préfèrent l’amour à la richesse, d’autres la liberté et l’aventure au conformisme et à la sécurité.
Le bon sens général semble vouloir mettre cependant certaines valeurs de l’existence en priorité, telles la santé et la prospérité.
Très peu de gens vont vous souhaiter la folie douce libératrice, l’audace, le débridage, la rupture de tous vos liens d’asservissement, voire l’illumination ou la transcendance. Alors, pour éviter la provocation, on vous souhaite, si vous êtes déjà sur le chemin spirituel, des vœux plus raisonnables tels le renforcement de votre cheminement ou sa révélation.
C’est déjà ça !
Le mot vœu vient du latin « votum », lui-même dérivé du verbe « vovere » qui correspond à une promesse faite à une divinité, à Dieu, dans le but de lui être agréable.
Il possède en lui un certain engagement.
Le vœu, par définition, serait investi d’un caractère sacré. Il s’agit en effet d’adresser des vœux à l’autre et à soi-même de façon solennelle.
Ainsi, chaque début d’année et de façon tacite chez un plus grand nombre, nous nous appliquons à ce partage de positivité avec nos proches ou avec un cercle de connaissances plus élargi.
Les vœux de début d’année s’accompagnent souvent d’une intention implicite pour soi-même, à savoir prendre de bonnes ou nouvelles résolutions.
Mais ces vœux ne sont en fait que des souhaits.
Il eut été louable que les vœux continssent les clés de leur réalisation !
Dans une société cartésienne et pragmatique telle que la nôtre, où nous avons perdu le lien avec le sacré, voire avec les divinités, nous gardons finalement les traces des rites anciens qui nous permettaient de conjurer le sort, les fléaux de la nature et d’obtenir du divin, prospérité et protection.
Ainsi, nous faisons de façon succincte, par quelques mots « choisis et rituéliques », la passation de l’année écoulée à la nouvelle, comme un face à face avec le destin, pour nous-même et pour l’autre.
Derrière cela se cache en vérité la peur de l’avenir et de notre infortune potentielle.
Des mots positifs reçus et donnés, vœux sans engagement ni promesse - donc faciles à partager - participent à entretenir une bonne humeur et une confiance dans l’avenir alors qu’au fond de nous, l’effroi de l’existence nous met dans un permanent qui-vive.
Les vœux de nouvelle année ont quelque chose de fondamentalement léger pour souhaiter des choses fondamentalement importantes.
Renouveler nos vœux, c’est privilégier la constance et la persévérance de vivre, bien qu’au
fil du temps, notre cercle d’amis ou de connaissances susceptible de recevoir nos bons vœux, puisse changer. Le cercle intime familial restant l’ancrage.
Malgré tout, nous avons déjà souhaité des vœux de santé à des êtres qui ne sont plus...
Ainsi donc, nous acceptons, avec ceux à qui nous souhaitons nos meilleurs vœux du moment, cette dure réalité de l’existence et partageons avec eux, un peu l’espoir qui nous donnera la force de la traverser et d’accéder au meilleur d’elle.
Le bon sens général veut donc la santé et la prospérité.
Venons en au bon sens !
« Le bon sens, selon Descartes, est la chose du monde la mieux partagée.
Cela témoigne de la puissance de bien juger et distinguer le vrai d’avec le faux, qui est proprement ce qu’on nomme le bon sens ou la raison, et serait naturellement égal en tous les hommes. »
Comme nous allons le voir, cela dépend malgré tout du point de vue de chacun. voir « L’indexicalité métaphysique »

Le bon sens serait-il spécifique à l’humain ?
Quand je vois mon chat, je me pose la question ...
L’homme à cette capacité à pouvoir raisonner dans une situation avec laquelle il peut tirer le meilleur parti de la situation.
Cela suppose la faculté de déduire des expériences et savoir faire les inductions les plus immédiates. Le raisonnement par induction est l’opération mentale qui consiste à remonter des faits à la loi, de cas particuliers à une proposition plus générale, processus opposé à la déduction).
Les vœux de bonne santé étant les plus fréquents, ils semblent obéir au bon sens commun qui fait qu’avec le temps et l’âge, tout être humain, faisant l’expérience de la dégradation qui détermine sa faculté à vivre ou non, est apte à estimer le précieux d’une bonne vitalité.
Nous faisons plus facilement des vœux de bonne santé lorsqu’on est soi-même plus âgé.
Il serait intéressant d’identifier chez les jeunes gens, quels sont les vœux les plus fréquents ? Une vie plus fun ? L’amour ? Le polyamour ? La liberté ? l’aventure ? La richesse ?
Nous pouvons alors nous poser la question suivante : est-ce qu’une bonne santé est la finalité de la vie ?
Avons-nous le bon sens pour vivre ?
Voulons-nous mener une vie de préservation et sans complication sachant qu’elle n’échappera pas à la décrépitude lente et inéluctable où la santé perdra le combat ?
Voulons nous vivre une vie de réalisation personnelle à n’importe quel prix ?
Voulons-nous vivre une vie qui trouve son propre sens ? Son propre « bon sens » ?
Pouvons-nous vivre sans le bon sens, en dépit du bon sens ?
Si pour les philosophes, le bon sens est donc une capacité propre à l’humain, un don de la raison, qu’est le bon sens pour un chercheur spirituel ?

« Le bon sens est en réalité limité et relatif, puisqu’il est conditionné par un mode de pensée particulier et un certain système social, éducatif et culturel. Le bons sens varie d’une société à l’autre, d’une communauté à l’autre, d’une époque à l’autre » nous dit Adrien Chœur.
Comme nous l’avons vu dans la conférence précédente, les évidences immédiates peuvent relever de l’illusion. Nos Jñāna Indriya ज्ञान इन्द्रिय (organes des sens) étant limités, notre expérience est limitée. Notre perception étant limitée, notre point de vue physique comme intellectuel n’englobe qu’une partie fausse ou vraie de la réalité.
Notre perception du monde peut être trompeuse et sa vérité ne peut se limiter à des cas particuliers. Platon illustre entre autres cela avec son allégorie de la caverne où le monde du sensible et de la perception ne prouve pas forcément la réalité. Dans son exemple, il démontre que la démarche par la pensée et les idées, voire la raison (le bon sens) peuvent dévoiler aussi la réalité.
Le bon sens peut-il s’illusionner ?
Le bon sens dans les expériences spirituelles est souvent mis à rude épreuve, tant les extrapolations « spiritueuses » diverses ont tribune. Il est extrêmement difficile d’avoir un esprit clair des lois universelles qui nous gouvernent si on les réduit aux seules définitions scientifiques ou bien lorsque la connaissance spirituelle métaphysique n’est pas assez aboutie voir conf « Le chemin, la caravane.
La plupart des pratiquants en yoga ou autres approches spirituelles peuvent projeter sur leurs expériences, leurs fantasmes mystiques, enjolivés du folklore new-âge ou des doctrines religieuses ou pseudo-religieuses.
La puissance d’une pratique avancée s’appuyant sur l’expérience quantifiable méditative, yoguique, énergétique, philosophique, métaphysique, alliée à la connaissance des textes sacrés, à la connaissance symbolique des pratiques et dont l’objectif est la transcendance, est apte à révéler chez le pratiquant l’évidence pure de la vérité universelle.
Cette vérité révélée intuitivement et identifiée en yoga par la fusion totale de l’être avec le principe métaphysique de l’absolu, à savoir le principe de Brahman ब्राह्मण, l’immuable inqualifiable, dépasse tout raisonnement intellectuel.
Cela relève de l’expérience directe. Le bon sens du pratiquant intervient alors pour corroborer l’évidence qu’il est en train de vivre.
Délicate expérience réservée à peu d’hommes mais dont les témoignages et les mutations sur l’être qu’elle entraine font de ces derniers des êtres hors du commun, des éveillés, des sages, des êtres totalement transformés.
Si une pratique de relaxation apaise, une pratique régulière méditative Dhyāna ध्यान calme et développe une vie intérieure, si un cours de prāṇāyāma प्राणायाम renforce le souffle et active le prāṇa प्राण, si des postures Āsana आसन assouplissent le corps et maintiennent la santé, cela relève du bon sens pour tout le monde, même pour ceux qui ne pratiquent pas. On y voit là le côté hygiéniste de la pratique yoguique.
Dans notre société contemporaine et matérialiste, c’est l’aspect du yoga qui est le plus pratiqué.
Les effets plus subtils et plus puissants concernant les pratiques visionnaires ou transcendantales que le yoga avancé apporte, ne sont pas évidents chez tout le monde. Ils ne le sont pas parce que monsieur tout le monde ne peut en faire l’expérience. C’est un problème d’entendement !
Ainsi donc pour un méditant, devant quelqu’un de dépressif ou d’agité, le bon sens serait de lui dire de s’arrêter, de fermer les yeux et de faire silence.
Pour un non méditant et pour une majorité de gens devant le même cas de figure, le bon sens sera d’aller dans la foule et le bruit, boire un verre pour se calmer et se détendre ou aller faire les courses à l’hyper marché.
Le bon sens est donc relatif à chacun de nous. Ainsi certains épargnent toute leur vie et meurent sans avoir profité de l’existence mais avec un pactole à la banque. D’autres crament tout et restent des aventuriers de la vie. D’autres encore assurent la sécurité matérielle tout en jouissant de l’existence. Dans chaque cas, c’est un choix qui leur apparaît relever du bon sens.
L’ego est-il associé au bon sens ?
l’ego veut toujours avoir raison et pense que son bon sens est le bon.
Ainsi beaucoup de personnes pensent l’avoir, en ont besoin mais l’ont-ils vraiment ?
Aristote dit ceci :
« Les hommes sont devant les idées simples comme des chauves-souris devant la lumière, ils sont aveugles ».
Souvent, lorsque les hommes sont nantis d’un bagage intellectuel, il leur devient difficile de cerner le bon sens tant ils peuvent se perdre dans les explications ou analyses de tous poils.
La direction que prend la société dite intelligente avec l’IA à son service, ne s’éloigne-t-elle pas de ce bon sens qui consisterait à préserver, voire développer dans d’autres directions que celle de l’hyper-technologie, notre propre intelligence au lieu de risquer de la remettre en question par le fruit de nos propres inventions ?
On associe plus souvent spontanément l’idée du « bon sens » à l’homme simple, le paysan, le manuel, le débrouillard, à celui qui parle directement avec les règles simples et incontournables de la nature dans son interaction avec elle et sait survivre en elle.
Cela n’enlève pas la fabuleuse proposition de l’IA à nous simplifier la vie, du moins à nous la simplifier en la complexifiant. Sommes-nous certains d’avoir pour nous-même, ce bon sens en validant ces orientations sociétales ou les acceptons-nous en dépit du bon sens ?
Sommes-nous aspirés malgré nous dans un tourbillon que d’autres humains, ailleurs ont mis en marche ? Lorsque vous êtes pris dans une tornade, quel est le bon sens ? Le bon sens eut été de l’éviter suffisamment avant !
Lorsque nous faisons un peu l’analyse de nos modes de fonctionnements et que l’on a assez vécu pour pouvoir revenir sur les leçons de nos nombreuses expériences, la plupart d’entre-nous trouveront forcément chez lui, de nombreuses démarches faites ou ayant été faites en dépit du bon sens.
Certains de ces choix nous ont menés dans des aventures fructueuses et d’autres catastrophiques. En ayant fait ces choix voir « Le choix judicieux », nous avons renoncé aussi à autre chose. Ce n’est souvent que très tardivement que nous prenons conscience de ce à quoi nous avons renoncé.
Dans cette analyse, nous pouvons aussi faire le bilan des bons choix raisonnables, ceux faits par le bon sens.
Le bon sens finalement ne doit-il pas être empreint d’un peu de folie pour qu’il se transcende lui-même et se révèle à un autre niveau de raisonnement ?

La citation d’Aristote me fait revenir sur celle de Djalâl ad-Dîn Rûmî, le poète persan.
J’y reviens très souvent car elle résume pour le poète comme pour le chercheur spirituel, « le bon sens métaphysique » sur lequel ils peuvent s’appuyer.
" Étranges ces créatures humaines, qui dans l’obscurité, pleurent sur leur propre immortalité !
Hari Om Tat Sat
Jaya Yogācārya
Bibliographie :
-« Le bon sens : définition philosophique et spirituelle » d’Adrien Chœur, parution dans Je Pense.org
– Réflexion et commentaire de Jaya Yogācārya
©Centre Jaya de Yoga Vedanta Ile de la Réunion & métropole
Remerciements à C. Pellorce pour ses corrections